La doctrine du droit bancaire (et financier) n'a pas été assez forte pour garder la matière hors du domaine consumériste. Ce fut une ambition du monde bancaire qui avait obtenu "sa loi" sur le démarchage (en 1972), hors du domaine général du droit de la consommation (domaine juridique patent avec la codification de 1993). Les professionnels de la banque n'ont jamais su penser cette autonomie juridique qui n'a pas pu inspirer une politique juridique.
La force du droit de la consommation était trop grande, pourra-t-on dire. Ce droit concerne donc souvent les relations juridiques d'argent, dites de droit bancaire, expression qui a désormais un sens équivoque. Le droit de la consommation occupe un terrain considérable, lui est ses institutions.
C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA.
L'affaire est intéressante car elle concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique...
Pour cette raison on évoquait les "petites affaires" et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE.
L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes...
Le problème posé est celui dit des commissions interchanges.
Page du ministère de l'économie sur cette sanction
La force du droit de la consommation était trop grande, pourra-t-on dire. Ce droit concerne donc souvent les relations juridiques d'argent, dites de droit bancaire, expression qui a désormais un sens équivoque. Le droit de la consommation occupe un terrain considérable, lui est ses institutions.
C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA.
L'affaire est intéressante car elle concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique...
Pour cette raison on évoquait les "petites affaires" et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE.
L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes...
Le problème posé est celui dit des commissions interchanges.
Page du ministère de l'économie sur cette sanction
Le ministère annonce que la sanction a été infligée pour des "manquements au règlement européen relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, à savoir la mise en place d’un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne."
La sanction est une amende administrative, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif).
Ce n'est pas une amende pénale (genre si rare), ce n'est pas un amende civile (très rare), et ce n'est pas une sanction pécuniaire comme l'ACPR et l'AMF en infligent dans le présent domaine bancaire et financier (mais ces dernières sont bien administratives).
Elle termine une enquête conduite par des agents habilités (C. cons., art. L. 511-7, 20°), en effet tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme.
L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives. contrairement à des idioties qui ont cours, la France n'est pas un régime totalitaire... Le décision d'amende peut être contestée devant le juge administratif et finalement devant le Conseil d'Etat ; voyez un exemple récent pour une amende notable :
CE, 7 avrils 2023, 9e et 10e ch. réunies, n° 461082, Société Orange
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-07/461082
La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside dans :
- le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de "super-loi" ;
- le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier.
L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015.
Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation.
Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises :
- il plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;
- il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;
- pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas 5 centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de 0,2 % ;
- il prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés directement sur le compte de l’entreprise ;
- il accroît la transparence sur le niveau de commissions payées par les commerçants, ce qui leur permet de sélectionner plus facilement les cartes de paiement à accepter.
Après ces dix points, qui devraient figurer dans un bref commentaire de cette annonce de la DGCCRF (c'est la phrase conseil aux étudiants, et à quelques autres), il faut définir ces commissions, en vérité célèbres.
En effet, outre les définitions dans les règlements précités (1), Wikipédia ose une page sur ce sujet qui offre une définition :
b[
La sanction est une amende administrative, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif).
Ce n'est pas une amende pénale (genre si rare), ce n'est pas un amende civile (très rare), et ce n'est pas une sanction pécuniaire comme l'ACPR et l'AMF en infligent dans le présent domaine bancaire et financier (mais ces dernières sont bien administratives).
Elle termine une enquête conduite par des agents habilités (C. cons., art. L. 511-7, 20°), en effet tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme.
L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives. contrairement à des idioties qui ont cours, la France n'est pas un régime totalitaire... Le décision d'amende peut être contestée devant le juge administratif et finalement devant le Conseil d'Etat ; voyez un exemple récent pour une amende notable :
CE, 7 avrils 2023, 9e et 10e ch. réunies, n° 461082, Société Orange
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-07/461082
La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside dans :
- le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de "super-loi" ;
- le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier.
L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015.
Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation.
Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises :
- il plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit des consommateurs et à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;
- il permet aux pays de l’Union de définir des plafonds inférieurs à 0,3 % pour les cartes de crédit des consommateurs ;
- pour les transactions par carte de débit des consommateurs, il permet aux pays de l’Union d’imposer une commission ne dépassant pas 5 centimes par commission d’interchange par opération en combinaison avec le plafond de 0,2 % ;
- il prévoit un nombre limité d’exemptions, telles que les cartes professionnelles utilisées uniquement pour des frais professionnels facturés directement sur le compte de l’entreprise ;
- il accroît la transparence sur le niveau de commissions payées par les commerçants, ce qui leur permet de sélectionner plus facilement les cartes de paiement à accepter.
Après ces dix points, qui devraient figurer dans un bref commentaire de cette annonce de la DGCCRF (c'est la phrase conseil aux étudiants, et à quelques autres), il faut définir ces commissions, en vérité célèbres.
En effet, outre les définitions dans les règlements précités (1), Wikipédia ose une page sur ce sujet qui offre une définition :
b[
La question de ces commissions avait, en France, en 2011, fait l'objet d'une décision de l'Autorité de la concurrence. L'affaire avait été initiée par un syndicat professionnel contre le GIE cartes bancaires. La question a aussi suscité du contentieux devant la CJUE.
On avait aussi appris qu'étaient en jeu plus d'un milliard d'euros, l'action de régulation ayant pu réduire ces coûts.
Avec une amende administrative (réglementée par la loi...), les faits et circonstances et les règles en cause ne sont pas connues, à la différence d'une sanction par les régulateurs ou par le juge qui doivent expliquer tout du litige et motiver leur décision.
La communication manque de précision et de coordinations ou références ; en effet, outre ARKEA, une SAS MONEXT aurait écopé d'une amende administrative de 450 000 €.
Le problème concret de la présente affaire serait celui d'un dispositif empêchant les consommateurs qui achètent sur le web de choisir leur réseau (qui est aussi une marque) de paiement (CB, Visa ou Mastercard) ; la réglementation européenne précitée favorise globalement la concurrence entre établissements et réseaux / systèmes de paiement, faut-il encore que le client qui paye puisse choisir.
L'absence du bon bouton ou des bonnes cases est problématique, le système (eh oui le système...) doit comporter les bonnes propositions / options où cliquer ; si le client ne peut pas payer comme il le souhaite, s'agissant de cartes avec plusieurs fonctions / possibilités, on peut penser que le système ou sa présentation par le PSP favorise certaines entreprises.
Il y a une dimension technique à comprendre et qui en partie nous échappe.
Selon le site economiematin.fr la banque a, dans un communiqué de presse, reconnu les faits et indiqué que la situation avait été corrigée depuis 2022 et que les consommateurs n'avaient pas été lésés. On entend financièrement... mais ils ont été privés d'un droit (que nombre de lecteurs ne percevront pas bien sans doute...).
Voilà qui est l'occasion de noter que le droit des services de paiement, soit des opérations de paiement, donne des droits étendus aux clients des prestataires de services de paiement (PSP), droits entendus largement par l'UE et qui ne se prêtent pas à des extensions jurisprudentielles puisqu'il s'agit d'une réglementation européenne.
Finalement, l'amateur pourra se demander quel aura été le rôle, s'il y en a eu un, de la BDF et de son agence de la conformité, l'ACPR. La régulation d'un domaine n'est pas la seule tâche du régulateur spécialisé...
A revoir après approfondissements !
_______________________
Règlement de 2015, art. 2, 10) :
«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange ;
On avait aussi appris qu'étaient en jeu plus d'un milliard d'euros, l'action de régulation ayant pu réduire ces coûts.
Avec une amende administrative (réglementée par la loi...), les faits et circonstances et les règles en cause ne sont pas connues, à la différence d'une sanction par les régulateurs ou par le juge qui doivent expliquer tout du litige et motiver leur décision.
La communication manque de précision et de coordinations ou références ; en effet, outre ARKEA, une SAS MONEXT aurait écopé d'une amende administrative de 450 000 €.
Le problème concret de la présente affaire serait celui d'un dispositif empêchant les consommateurs qui achètent sur le web de choisir leur réseau (qui est aussi une marque) de paiement (CB, Visa ou Mastercard) ; la réglementation européenne précitée favorise globalement la concurrence entre établissements et réseaux / systèmes de paiement, faut-il encore que le client qui paye puisse choisir.
L'absence du bon bouton ou des bonnes cases est problématique, le système (eh oui le système...) doit comporter les bonnes propositions / options où cliquer ; si le client ne peut pas payer comme il le souhaite, s'agissant de cartes avec plusieurs fonctions / possibilités, on peut penser que le système ou sa présentation par le PSP favorise certaines entreprises.
Il y a une dimension technique à comprendre et qui en partie nous échappe.
Selon le site economiematin.fr la banque a, dans un communiqué de presse, reconnu les faits et indiqué que la situation avait été corrigée depuis 2022 et que les consommateurs n'avaient pas été lésés. On entend financièrement... mais ils ont été privés d'un droit (que nombre de lecteurs ne percevront pas bien sans doute...).
Voilà qui est l'occasion de noter que le droit des services de paiement, soit des opérations de paiement, donne des droits étendus aux clients des prestataires de services de paiement (PSP), droits entendus largement par l'UE et qui ne se prêtent pas à des extensions jurisprudentielles puisqu'il s'agit d'une réglementation européenne.
Finalement, l'amateur pourra se demander quel aura été le rôle, s'il y en a eu un, de la BDF et de son agence de la conformité, l'ACPR. La régulation d'un domaine n'est pas la seule tâche du régulateur spécialisé...
A revoir après approfondissements !
_______________________
Règlement de 2015, art. 2, 10) :
«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange ;

 L'auteur, contact et Informations légales ISSN
L'auteur, contact et Informations légales ISSN
 Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions interchange.
Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions interchange.

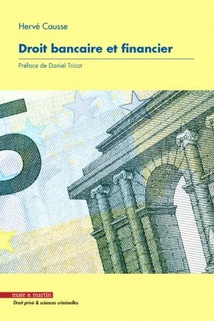

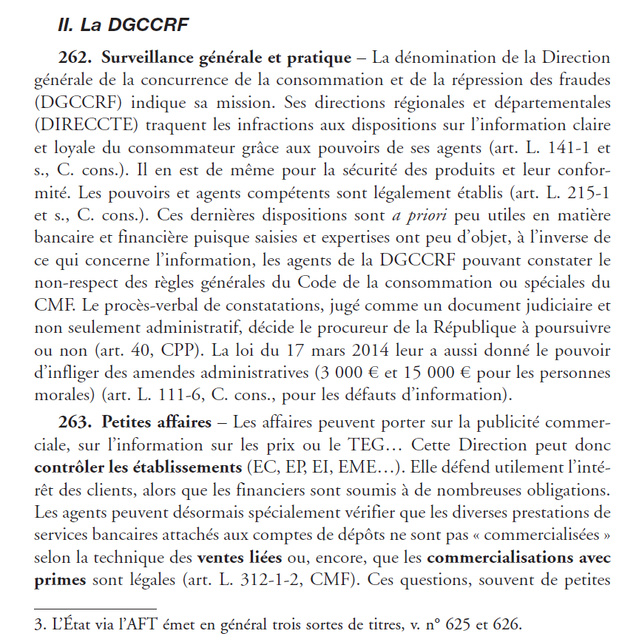


 L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)
L'emprunteur sénior : sa décision de partir en retraite implique une mise en garde de la banque ou de l'organisme financier. Sérieusement ? (Cass. com., 27 mars 2024, 22-13.124)